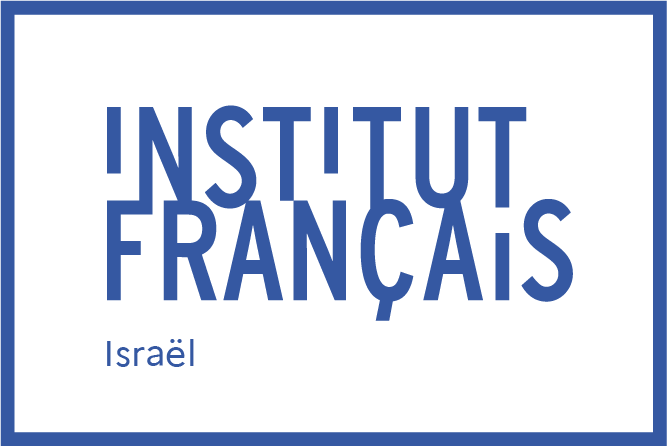Notes tel-aviviennes – Perec Boulevard Rothschild
Notes tel-aviviennes – Perec Boulevard Rothschild
Avraham Balaban, Ha’aretz, Supplément littéraire, 19 novembre 2024
Boulevard Rothschild, jeudi, six heures et demie du soir. Les lumières des lampadaires confèrent aux troncs des ficus une teinte argentée. Les flamboyants, pour certains, s’ornent de leur floraison automnale, tandis que d’autres s’illuminent momentanément sous l’effet des néons rouges qui éclairent le côté est de la rue. Plus on se dirige vers le sud, plus la structure de la rue devient évidente : à l’est, une rangée de tours abritant des banques, des hôtels et des résidences ; à l’ouest, des restaurants animés remplis de convives à cette heure.
Je me tiens devant un bâtiment éclectique spectaculaire au numéro 49. Sur sa façade, derrière un groupe de palmiers anciens, brille l’inscription : Christina House TLV. Dans environ une heure, une exposition dédiée à l’univers de l’écrivain franco-juif Georges Perec ouvrira ses portes à l’Institut français, au 7 Boulevard Rothschild. Je ne peux m’empêcher de penser aux merveilles que Perec aurait su tirer de ce bâtiment : de ses origines dans les années 1920, en passant par les liens familiaux entre les fondateurs de Tel Aviv, jusqu’aux transformations des matériaux de construction, des meubles, des vêtements et de la langue hébraïque au cours des cent dernières années, sans oublier l’immense métropole qui a fleuri autour de cet édifice. Aujourd’hui, les femmes du quartier y bénéficient de soins cosmétiques grâce à une société nommée Christina, située dans ce bâtiment classé du 49 Boulevard Rothschild.
L’exposition est fascinante. Elle m’a reconnecté aux œuvres enchanteresses et pleines de mystères de Georges Perec, et flâner sur le Boulevard Rothschild en soirée est un véritable plaisir.
Il y a quelque chose de contagieux dans l’écriture multi-dimensionnelle et multi-couches de Perec (un parent éloigné de Y.L. Peretz), l’un des plus grands écrivains français de la seconde moitié du XXe siècle. Dr Smadar Sheffi, commissaire de l’exposition que je m’apprête à visiter, a découvert cet enchantement dès son adolescence, en lisant une critique enthousiaste sur La Disparition de Perec, un roman écrit entièrement sans utiliser la lettre « e », la plus fréquente en français. Lors d’un appel téléphonique, elle m’a raconté combien elle avait été fascinée par l’idée qu’un écrivain puisse transformer la langue en un jeu, qu’il puisse s’imposer des contraintes, comme s’attacher les pieds, uniquement pour prouver qu’il pouvait courir et sauter comme n’importe qui, même enchaîné. Depuis, elle lit avec passion les œuvres de Perec et revient sans cesse à son œuvre maîtresse, La Vie mode d’emploi (traduit en hébreu par Ido Bassouk, Babel Éditions, 2009).
Dans La Vie mode d’emploi, Perec explore un immeuble fictif à Paris, étage par étage, décrivant ses habitants avec un réalisme inégalé et une imagination débordante. Il crée ainsi un cosmos complet, mêlant cultures passées, avancées scientifiques, matériaux et littérature. Il ne manque pas d’y glisser des indices autobiographiques, notamment sur sa mère, assassinée à Auschwitz en 1943. Sheffi, conservatrice d’art contemporain à la Maison Bialik, m’a confié qu’en 2013, lorsqu’elle a vu une exposition photographie d’Ofer Bessudo documentant des maisons de Tel Aviv depuis l’extérieur, à la tombée de la nuit, elle avait immédiatement pensé aux descriptions intérieures et extérieures des bâtiments dans La Vie mode d’emploi. D’autres œuvres qu’elle a vues au fil des années ont enrichi cette vision du monde. Finalement, au début de cette année, elle a proposé à l’Institut français d’organiser une exposition inspirée de Perec. L’équipe de l’Institut, et en particulier Yaël Baruch, sa responsable de projets artistiques, a accueilli l’idée avec enthousiasme. L’exposition, qui s’ouvre ce soir, porte le titre Troisième droite, 3, du nom d’un chapitre de La Vie mode d’emploi.
À l’extrémité sud du Boulevard Rothschild, le paysage change : le côté ouest domine cette fois depuis les hauteurs de la Tour Psagot (Rothschild 3), surplombant le côté est. La mosaïque de verre Petite Tel Aviv de Nachum Gutman reste dans l’ombre devant la Tour Rothschild 1.
Il est sept heures du soir. Seuls quelques amateurs de Perec arpentent la modeste galerie de l’Institut, me laissant le loisir d’explorer tranquillement les œuvres exposées. Au centre de la salle trône l’œuvre d’une artiste née en Russie, Ira Prohorova. Son installation, intitulée Là où…, présente quatre portes étroites (27 cm chacune), reliées entre elles pour former une sorte de totem mystérieux. Chaque porte a une poignée dans une position légèrement différente, mais elles sont toutes fermées, protégeant un espace entre elles qui, en réalité, n’existe pas. Il s’agit d’une erreur de ma part : en observant les poignées, je réalise que je ne regarde pas les portes de l’extérieur, mais comme si j’étais à l’intérieur d’une pièce verrouillée.
Sheffi arrive et me raconte qu’elle avait vu cette œuvre en juin dernier, lors de l’exposition de fin d’études de Prohorova au Seminar HaKibbutzim. Elle avait immédiatement perçu l’esprit de Perec dans cette création. L’artiste confirme : elle connaissait bien le livre de Perec, Espèces d’espaces, consacré aux différentes formes d’espace. Arrivée de Russie il y a neuf ans, à l’âge de 25 ans, elle a beaucoup réfléchi aux espaces qu’elle a traversés dans sa vie, et surtout à la notion de « maison ». La guerre du 7 octobre a intensifié ces réflexions, révélant que même les portes les plus solides ne constituent pas une véritable protection. Ainsi, Perec et cette guerre atroce se sont mêlés pour donner naissance à un projet de fin d’études impressionnant.
La commissaire m’introduit à Ofer Bessudo, dont les photographies ornent les murs de la galerie. Le titre de ses clichés, 30-15, fait référence au temps d’exposition de l’objectif. La galerie s’est entre-temps remplie de visiteurs, et je m’assois avec lui sur un banc du boulevard. Ofer explique qu’il est fasciné par ce qui se passe dans les appartements de Tel Aviv après la tombée de la nuit. Lorsqu’on photographie une pièce éclairée, dit-il, on ne voit rien sur l’image. Pour capturer l’essence de ces espaces anonymes, il faut les photographier dans l’obscurité. En ce sens, il travaille comme un chasseur : il photographie sans relâche, et ce n’est qu’au développement qu’il sait si la chasse a été bonne. Je suppose que souvent, elle ne l’est pas, mais les clichés exposés ici sont captivants : ils saisissent le quotidien indifférent de Tel Aviv avec ses stores fissurés, ses meubles en désordre, ses bibliothèques et ses plantes à moitié desséchées.
L’œuvre de Barak Ravitz, Clôture, évoque les descriptions des matériaux architecturaux omniprésents dans les livres de Perec. Sa sculpture en aluminium imite avec précision une clôture ornementale en plastique, elle-même conçue pour ressembler à du bois. Cette tentative moderne de reproduire des objets et matériaux naturels par des moyens industriels est ici exposée avec un humour mordant et ironique.
Je ne peux écouter la vidéo La Bibliothèque d’Ira Eduardovna, car la galerie est maintenant pleine de visiteurs. Je remercie la commissaire, dont l’exposition m’a poussé à relire La Vie mode d’emploi cette semaine, et je lui promets de revenir bientôt. Cette promesse sera facile à tenir : l’exposition est fascinante, et elle m’a reconnecté aux œuvres magiques et énigmatiques de Georges Perec. Et flâner sur le Boulevard Rothschild en soirée reste un réel plaisir.